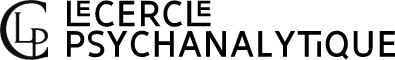Transmettre nos héritages, par Jalil Bennani
Introduction
Nos maîtres nous ont donné un enseignement, une formation, une expérience. Mais comment restituer, enseigner, transmettre ce que nous avons nous-mêmes appris ? Transmettre, c’est prendre appui sur l’héritage qui nous a été légué non pour le reproduire fidèlement mais pour le renouveler. Il ne s’agit pas ici de la transmission d’un droit à une autre personne, comme celui de propriété par exemple, ni d’une transmission des pouvoirs, ni d’une succession. La transmission à laquelle nous nous intéresserons concerne les théories et les pratiques que l’on a acquises. Comment leur donner un présent, une contextualisation et une actualité ?
La transmission n’est pas une simple suite d’évènements continus. Elle est aussi faite de ruptures et de discontinuités. Elle est le fruit d’une évolution des idées, des pratiques et des concepts qui se sont constitués tout au long de l’histoire. Psychiatres exerçant au Maroc, nous sommes, en outre, pour la plupart d’entre nous, les héritiers d’une filiation plurielle quant à nos pratiques professionnelles : arabe, maghrébine, européenne.
Les pratiques thérapeutiques se trouvent souvent au croisement des va-et-vient d’une culture à l’autre, d’une langue à l’autre. Elles doivent prendre en compte le mouvement des sujets et de leurs symptômes. Comment intégrer les connaissances extra-occidentales à celles de la psychiatrie, des psychothérapies et de la psychanalyse aujourd’hui d’origine occidentale ? Quelles sont les ruptures épistémologiques qui s’opèrent dans la théorie ? Quels en sont les effets au niveau des pratiques psychothérapiques ?
Je rappellerai brièvement l’état de lieux de ces pratiques et je proposerai des pistes de réflexion permettant d’articuler le discours des croyances à celui de la science, à travers la parole du patient, prise dans sa diversité culturelle et son décentrement. Je conclurai par les questions qui se posent à nous aujourd’hui avec acuité et nous imposent de repenser nos acquis.
Le terrain des traditions
Les croyances et les pratiques traditionnelles se parlent dans les consultations médicales ou psychologiques, pour peu que le praticien se montre ouvert à leur écoute, sans à priori ou précipitation et se retient de les étiqueter dans une catégorie diagnostique. Ainsi, au Maroc, comme dans de nombreux pays africains, les djinns, esprits surnaturels, sont tenus pour responsables des maladies physiques et mentales. Les pratiques de la magie sont toujours présentes et fréquemment associées à la religion dans les pays musulmans. Citons aussi le phénomène quasi-universel de la transe (hadra), que l’on rencontre en Éthiopie, au Niger, au Brésil… L’une des plus connues au Sénégal est le Ndop. Comme toutes les conduites, elle est dès l’origine modelée par la culture.
Quant aux acteurs, traditionnellement, le savoir-faire est celui du guérisseur, du magicien, du saint (syed) et du personnage religieux. Ces acteurs sont vantés par la population pour leur mérite personnel, leurs exploits et les soins qu’ils prodiguent. Un pouvoir leur est conféré par ceux qui les consultent pour des motifs divers, allant des conseils à des rituels spécifiques. Il convient d’entendre les pratiques traditionnelles dans leur efficacité symbolique[1]. Elles constituent le fond des pratiques ancestrales à partir duquel une démarche rationnelle scientifique s’est édifiée dans l’Antiquité, à l’époque classique arabe puis dans la modernité occidentale. Commençons par celle-ci dont nous héritons directement.
Les pratiques contemporaines
La psychiatrie
La psychiatrie classique européenne fut portée au cours des XVIIIe et XIXe siècles par Pinel, Esquirol, Falret, Kraepelin, Bleuler, Sérieux, Charcot et d’autres grands noms. En s’appuyant sur un savoir scientifique, l’identification et la classification des troubles mentaux ont permis d’asseoir l’organisation des hôpitaux psychiatriques. En nommant les maladies mentales, en les classant et en recherchant des causes internes, les psychiatres sont parvenus à les isoler comme objet d’étude : c’est cette rationalité scientifique qui les distingue des praticiens de la magie. Cette psychiatrie a connu de grands débats jusqu’au siècle dernier et connu un développement décisif non seulement en définissant les grandes catégories, mais aussi en apportant une intelligibilité à la maladie, son évolution et son traitement.
Depuis l’époque du protectorat au Maroc et jusqu’aux années quatre-vingt du siècle dernier, la psychiatrie classique européenne a dominé l’enseignement et les pratiques. Par la suite, c’est le DSM (Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, d’origine américaine) qui a prévalu. En privilégiant l’aspect descriptif des maladies, la théorie s’en est trouvée appauvrie. Alors que les deux premières versions du manuel (DSM I et II, 1952-1968) étaient influencées par la psychopathologie psychanalytique, la troisième et les suivantes (1980-2015) ont marqué un tournant avec une orientation comportementaliste et antipsychanalytique. On sait que l’aspect purement descriptif et la multiplication croissante des catégories diagnostiques ont donné lieu à de nombreuses controverses depuis.
Tous les systèmes nosographiques dans le domaine de la psychiatrie ont connu un perpétuel remaniement. Il en découle différents usages selon les époques et les contextes. Les intrications entre une maladie, son traitement, les considérations socio-politiques et économiques sont nombreuses. Chaque époque a connu ses théories et ses concepts qui intègrent la question historique et l’évolution de la pensée.
Des questions cruciales relatives à la manière dont la norme s’introduit dans nos sociétés doivent aussi être évoquées. Rappelons que la « normativité » définie par Georges Canguilhem désigne la capacité de produire des normes pour pouvoir s’adapter et avoir un équilibre dans la vie[2]. Les notions de « normal » et « pathologique » ont fait l’objet depuis le siècle dernier de polémiques et de débats au sein de différentes disciplines, notamment la philosophie, l’anthropologie, la psychiatrie et la psychanalyse. La distinction des deux notions serait-elle d’ordre quantitatif ou qualitatif ? S’agit-il d’une différence de degré ou de nature ? Ou les deux ? La frontière entre le normal et le pathologique chez les individus peut se réduire considérablement, les symptômes présents chez les personnes souffrant de pathologies psychiques se retrouvent à bas bruit chez celles considérées comme normales
Les psychothérapies et la psychanalyse
Les principales psychothérapies pratiquées aujourd’hui sont les thérapies cognitivo-comportementales, les thérapies issues de la psychanalyse, les thérapies familiales. De nombreuses techniques sont venues s’y rajouter notamment l’EMDR[3], les thérapies interpersonnelles, la gestalt-thérapie… Quel que soit le contexte culturel, elles reposent sur les mêmes concepts et postulats épistémologiques qu’en Occident[4].
La psychanalyse s’est développée au Maroc comme dans les pays européens sur un fonds de savoir psychiatrique et a enrichi le champ de la psychopathologie. La particularité de la cure psychanalytique consiste à laisser le patient parler de ses difficultés dans les termes qui sont les siens, c’est-à-dire à ne pas faire interférer dans son récit un discours d’un autre type, fût-il scientifique. L’expression personnelle des troubles est donc respectée en tant que telle, même si ultérieurement au cours de la cure ce discours premier émanant du patient peut changer et permettre d’accéder à une distance rendant possible une évolution positive de la cure elle-même. En étant à l’écoute de sa parole individuelle et de son désir, il peut évoquer sa fréquentation des lieux traditionnels tout comme l’espoir qu’il fonde sur le thérapeute qui se réfère à la science.
Il est fréquent que les patients consultent à la fois des praticiens traditionnels, des hommes de religion et des psychothérapeutes, faisant coexister plusieurs types de discours et de pratiques, à la recherche d’un soulagement, une complémentarité entre les sources de bien-être ou de spiritualité. Il se produit dès lors un transfert de croyance. Le pouvoir traditionnellement attribué à un thérapeute traditionnel se trouve conféré à l’homme de science. Notons cependant que s’adresser à la science ne consiste pas seulement à faire confiance en la quantification ou la recherche de preuves, mais que cette démarche possède en son sein une part de fantasme, qui peut se manifester dans la toute-puissance accordée au psychothérapeute.
Ainsi, il devient possible d’inclure les données extra-occidentales à celles de la psychiatrie, des psychothérapies et de la psychanalyse. C’est une nécessité dictée par la pratique et par l’évolution des idées. L’histoire de la psychiatrie est faite de ruptures, de sutures, de réparations. D’une histoire à l’autre, d’une technique à l’autre, les traces laissées par les pratiques se superposent et connaissent un remaniement permanent. Georges-Lantéri Laura (1930-2004) figure marquante de l’épistémologie psychiatrique en France, souligne : « Notons d’abord que presque toutes les cultures connues – et nous ne disons : presque toutes, que par une extrême prudence – comportent des représentations sociales de ce que, dans notre propre culture, nous entendons par folie… les représentations sociales de la folie sont premières et la psychiatrie, quand elle existe, s’avère toujours seconde… » Ainsi, ne l’oublions pas, la psychiatrie est venue se greffer sur les représentations populaires de la folie. Les traditions populaires maghrébines consacrent différentes appellations à la folie, chacune renvoyant à un état particulier : meskoun (« habité »), madroub (« frappé par le démon »), mashour (« ensorcelé »), mehbul (qui a perdu la raison). La psychiatrie définit les catégories de « névroses », « psychoses », « troubles de l’humeur », « états limites » et autres qui viennent se superposer aux représentations populaires qui l’ont précédée.
Discours des croyances, discours de la science
Deux rationalités
Dans la pratique clinique, on peut assister à une tension féconde entre les cultures ouverte sur un questionnement, une recherche de complémentarité entre elles. On considère généralement que les traditions populaires sont irrationnelles mais selon les contextes, des pratiques et croyances irrationnelles peuvent servir et alimenter une démarche rationnelle. Ainsi, dans la magie la plus irrationnelle on trouve des concepts qui peuvent être retravaillés rationnellement. Rappelons avec Marcel Mauss qu’elle a donné lieu à des découvertes scientifiques[5]. Elle possède ses raisonnements et sa logique interne. La science quant à elle s’inscrit dans une tradition de rationalité conceptuelle qui remonte aux Grecs, aux médecins philosophes arabes avant de se retrouver des siècles plus tard en psychiatrie.
Nous nous trouvons face à deux ordres de rationalités mythique et scientifique. Elles ne sont pas superposables mais articulables : c’est à cette tâche que nous sommes constamment confrontés dans nos pratiques thérapeutiques. En opérant une double approche, intégrant l’apport des pratiques et connaissances non occidentales avec celles de la psychiatrie et de la psychanalyse, d’un système à l’autre, il devient possible d’analyser de façon raisonnée les expériences et les théories rationalistes qui se sont succédé. Cela me conduit à relever les ruptures épistémologiques qui s’opèrent dans les théories.
Les ruptures épistémologiques
S’agissant de la notion de « rupture épistémologique », Gaston Bachelard demeure une référence incontournable[6]. Scientifique, philosophe, épistémologue et historien, ses travaux lui permettent decomprendre la raison humaine, la rationalité dans toute son ampleur et sa variété. Elle me permet d’historiser les apports théoriques qui se sont produits au sein de la médecine, de la psychiatrie et enfin de la psychanalyse[7].
La première rupture épistémologique par rapport au savoir mythologique est le fait de la médecine arabe. Les médecins savants Al-Râzi (Rhazès, 895-925), Avicenne (Ibn Sina, 980-1037), Averroes (Ibn Rushd, 1126-1198)… pour ne citer qu’eux, ont tenté de fournir des explications rationnelles aux phénomènes de la magie en invoquant l’influence des astres sur les individus. Même si ces explications se sont avérées ultérieurement erronées, elles ont constitué un moyen pour chercher des causes aux faits qu’ils observaient, en se détournant des explications empiriques. Le mouvement de la science c’est le mouvement de la rationalisation et non pas un dogme fixé une fois pour toutes : il consiste à essayer de décrire les conditions permettant une objectivité en déterminant un plan d’intelligibilité qui soit différent de l’objet qu’on étudie pour le clarifier.
La deuxième est celle de la psychiatrie classique européenne. Avec le rationalisme des Lumières, la folie a basculé du côté de la médecine et prit le nom de « maladie mentale ». Les sorcières n’ont plus été persécutées et leur mal fut considéré comme relevant de la psychiatrie [8]. Les causes, la description des symptômes, le pronostic des troubles psychiques furent établis sur le modèle médical. Ce faisant, les psychiatres ont décrit objectivement ces troubles. La maladie, la folie traditionnellement attribuée à des forces externes – qui mettent le sujet en état de passivité face à une emprise qui le dépasse – relèvent désormais de son histoire et sont attribuées à des causes internes avant d’être liées à l’environnement.
La troisième est celle de la psychanalyse. Un tournant est effectué du passage de l’objectivité à la subjectivité de la souffrance. L’intérêt est porté sur les effets des croyances sur le sujet. Sur le divan du psychanalyste le patient est invité à dire tout ce qui lui vient à l’esprit. Le psychanalyste intègre tous ses propos dans leur symbolique culturelle. Il prend appui sur le langage pour interpréter les phénomènes inconscients. Chaque sujet est unique et son implication consciente et inconsciente est à l’œuvre dans les processus mentaux.
Conclusion
De plus en plus sollicités, les psychiatres se trouvent confrontés aux défis majeurs de notre temps. On a vu que la crise de la Covid a engendré angoisses, dépressions et décompensations de pathologies diverses, soulignant l’importance de la santé mentale. Les spécialistes sont attendus dans les situations de traumatismes, de violences, de guerres, de fanatismes. On assiste à des nouvelles pathologies comme les addictions aux drogues et au digital, les conduites à risques. Les fécondations in vitro, les nouvelles maternités, les débats relevant du transgenre soulèvent de nombreuses questions éthiques. Les questions du « normal » et du « pathologique » sont réinterrogées.
Avec le développement considérable du numérique, de nouvelles techniques d’investigation, de recherche et de prévention se développent. Comment repenser la clinique lorsqu’on consulte à distance par smartphones ou par vidéo ? Comment penser l’absence des corps ? La délégation aux machines engendre de nouvelles croyances, les algorithmes créant des prédictions et imprimant à notre insu des nouveaux besoins et conduites.
Les données de l’imagerie cérébrale permettent non seulement d’enrichir la connaissance du cerveau mais aussi de montrer les articulations entre l’expérience, l’environnement, le langage et les neurotransmetteurs, entre les faits psychiques et les faits biologiques. On connaît les découvertes fondamentales de la plasticité neuronale et le rôle de l’épigénétique [9].
Les traditions se sont nourries des apports philosophiques et scientifiques qui ont promu une certaine liberté de pensée et contribué aux évolutions des sociétés. Elles ne sont jamais pures, elles ont intégré tout au long de l’histoire différentes influences héritées d’autres cultures.
Il faut ouvrir les pratiques et les savoirs, inventer de nouveaux paradigmes. Les théories naissent et évoluent dans le temps. On le voit bien dans le mouvement de la science. Elle ne constitue pas une vérité en soi et ne cesse d’évoluer dans le temps. Ainsi donc, la transmission suppose un double mouvement : se réapproprier ce que l’on a appris et porter cet acquis ailleurs, d’un lieu à un autre, d’une époque à une autre, d’une culture à une autre, d’une langue à l’autre.
Texte publié pour la lettre de l’Association Marocaine des Psychiatres d’Exercice Privé
[1] « Efficacité symbolique » : expression proposée par Claude Lévi-Strauss pour expliquer que les mots, les gestes, les postures peuvent soigner (Anthropologie structurale, Paris, Plon, 1958).
[2] Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, PUF, Paris, 2011, p. 155.
[3] Les initiales EMDR signifient « eye movement desensitization and reprocessing », c’est-à-dire « désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires ». Francine Shapiro, psychologue américaine a découvert par hasard en 1987 ce moyen pour stimuler un mécanisme neuropsychologique complexe permettant de traiter des vécus traumatiques.
[4] Je fais référence ici à « l’Occident », non pas en tant que région mais comme une manière de penser qui a émergé en Grèce, à la renaissance italienne et ailleurs : une certaine façon d’exercer la science.
[5] Pour Marcel Mauss « La magie se relie aux sciences… Elle n’est pas seulement un art pratique, elle est aussi un » trésor d’idées » ». Il rappelle que les magiciens alchimistes, astrologues et médecins ont été en Grèce et ailleurs « les fondateurs et les ouvriers de l’astronomie, de la physique, de la chimie, de l’histoire naturelle », (in Sociologie et Anthropologie, P.U.F., 1978, p. 136).
[6] Gaston Bachelard, La formation de l’esprit scientifique, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, p. 17.
[7] Cf. les développements apportés dans mon ouvrage Des djinns à la psychanalyse, nouvelle approche des pratiques traditionnelles et contemporaines, Les presses du réel, Paris, 2022.
[8] Je n’entre pas ici dans la polémique sur l’enfermement des fous soulevé par Michel Foucault qui fut récusé par les praticiens notamment Claude Quetel (Histoire de la folie, de l’Antiquité à nos jours, Tallandier, Paris, 2009).
[9] On peut voir à ce sujet les recherches du psychanalyste François Ansermet et du neurobiologiste Pierre Magistretti (cf. leur ouvrage A chacun son cerveau. Paris : Odile Jacob, 2004 ; réédition Poches, 2011).