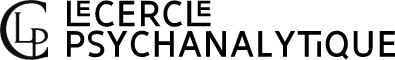Coronavirus : une crise du vivant
Quand pourrons nous dire : « Il était une fois le corona » ? À l’heure où ces lignes sont écrites, nous demeurons face à une grande inconnue. Les promesses, les croyances, l’espoir d’une sortie de crise, après trois mois de confinement, n’ont pas été au rendez-vous. Croire que cette crise était une parenthèse relevait d’une une vue bien courte. L’épidémie est installée pour une longue durée. Quel sera l’avenir de notre vie sociale, de nos liens, de nos activités ? Pour quelle raison les grandes catastrophes de l’humanité tombent-elles dans l’oubli ? Il y eut la peste noire, la variole, la grippe espagnole, le sida, le choléra, Ebola… La grippe de Hong-Kong a fait de 1968 à1969 un million de morts dans le monde. Le Maroc a connu de très graves épidémies aux XVe et XVIe siècles qui ont décimé une grande partie de la population. À cette époque, en l’absence de données scientifiques, l’épidémie était considérée comme une punition divine. Aujourd’hui, les hommes de religion composent avec les données de la science en implorant l’aide de Dieu face à cette maladie. L’oubli est bien souvent une nécessité de l’homme pour continuer à vivre, pour ne pas endurer constamment des souffrances. En même temps, il est nécessaire de se remémorer l’histoire. Le futur ne peut pas être pensé sans le passé et le présent.
L’épidémie de la Covid-19 nous a montré de quelle manière les chercheurs avancent. La science n’est pas porteuse de vérités absolues, ses théories changent avec les découvertes nouvelles. Nous constatons de façon prégnante que la recherche doit être résolument pluridisciplinaire. Les analyses épidémiologiques, anthropologiques, économiques et politiques ont montré que la crise était inévitable. Mais nul ne pouvait prédire quand elle se déclencherait. Nous pouvons dire qu’elle relève de la contingence, de l’inattendu. Les sociétés n’étaient pas préparées pour y faire face, bien qu’elles aient contribué à la dérégulation de la planète. Les politiques de santé, les désastres écologiques, la course au néolibéralisme furent sans doute les causes déclenchantes de cette crise. Dans un ouvrage récent, intitulé Et si l’effondrement avait déjà eu lieu, le psychanalyste Roland Gori montre que tous les ingrédients de l’effondrement étaient là : les mutations climatiques, la course à la rentabilité, les dysfonctionnements sociaux, les exigences toujours plus grandes de productivité et d’utilitarisme, ajoutés aux inégalités sociales et aux atteintes à la dignité humaine. Cette crise en a été le révélateur. Les structures de santé ont montré leurs défaillances, l’économie s’est effondrée, les liens sociaux ont été considérablement affectés. Les anthropologues de la santé nous ont montré que les virus existent dans notre corps et dans la nature par milliards, mais ils ne sont pas tous virulents, certains permettent de combattre des bactéries et sont même utilisés dans la recherche fondamentale. L’homme a conquis des espaces naturels qui ont rétréci celui des autres êtres vivants. L’animal s’est rapproché de l’homme ! Les êtres humains ne sont pas seuls sur terre. La notion du vivant est à entendre au sens large. Une société est constituée d’une multitude d’êtres qui réagissent les uns avec les autres. Louis Pasteur disait : « Le microbe n’est rien, le terrain est tout ». Notre relation avec le vivant est en crise.Faute d’avoir anticipé les causes, la course aujourd’hui est au remède introuvable et au vaccin probable.
De nouvelles pathologies sont apparues, et celles qui préexistaient à la crise se sont exacerbées. Sur le plan psychique, les angoisses, les insomnies, les dépressions et autres troubles psychiques ont dominé les préoccupations relatives à la santé. La prise de conscience de l’importance de la santé mentale a été telle que le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a appelé les pays à donner davantage de moyens à ce secteur. « Le virus de la Covid-19 n’attaque pas seulement notre santé physique, elle augmente également les souffrances psychologiques », a-t-il souligné en rappelant les « décennies de négligence et de sous-investissement dans les services de santé mentale ». Les Nations unies ont ainsi appelé les gouvernements à investir sans délai dans ce domaine longtemps sous-financé. La distanciation sociale a produit des effets paradoxaux : elle a engendré des rapprochements affectifs, des solidarités mais également des souffrances et des ruptures sociales. En se prolongeant, l’isolement peut aboutir à une perte du contact relationnel, du regard sensible et de la présence charnelle. Le changement spatial a considérablement changé notre rapport au temps. Il y a un temps subjectif, intérieur et un temps objectif, celui de la montre. Le temps peut nous sembler s’arrêter, paraître long ou court, selon nos occupations et la situation que nous vivons. La perception du temps est intimement liée aux émotions qui augmentent le désarroi des anxieux percevant les situations menaçantes comme plus longues. L’ennui aussi peut être source de grande terreur. L’homme ne peut pas vivre naturellement en confinement. « L’homme est un animal politique » a dit Aristote. Pour le philosophe, cela signifie que l’homme vit au milieu de ses congénères dans une cité soumise à des lois. Le confinement est une décision de l’État, les gouvernants devant protéger la vie et la sécurité des citoyens. L’homme n’est pas le seul à vivre socialement, ses réactions, ses réflexes et ses mimétismes sont apparentés à ceux de l’animal, mais il possède une sociabilité et des relations avec ses semblables beaucoup plus évoluées. Ce qui le différencie fondamentalement de l’animal, c’est le langage. Grâce à la parole, nous pouvons communiquer, nous exprimer et être présents au monde. Nous avons besoin des autres pour nous identifier, nous rassembler, partager ; c’est la raison pour laquelle le confinement, qui est subi, est aussi source d’isolement, de souffrances, de solitude, de séparation avec les proches. Les enfants, comme les adultes, ont besoin du social.
La crise nous a révélé des choses essentielles. Parmi celles-ci, je voudrais insister sur le rôle prépondérant de la culture. Elle est au cœur du lien social. Elle est source de richesse, nourrit la mémoire des civilisations et entretient l’histoire des peuples, le patrimoine matériel et immatériel des pays. La culture est un partage entre des individus. Elle donne un sens, des places structurées pour chacun et des modèles de conduite ou d’inconduite : ainsi l’ordre et le désordre moral ont été différemment appréciés et intégrés selon les civilisations et les époques. Chacun, adapté ou marginal, créateur, névrosé ou délirant, puise dans le fonds commun ethnico-culturel, des outils de représentation imaginaires et d’expression pour dire sa subjectivité sous une forme reconnue par le groupe culturel. C’est ce qu’on désigne par « lien social ». La culture donne un cadre à l’individu pour s’adapter aux autres, lui permettre d’enrichir la collectivité ou au contraire l’en exclure. C’est tout le sens à donner au vivre-ensemble, dont les catastrophes nous révèlent l’urgente nécessité. Qu’est-ce que le lien social ? En droit, c’est principalement par l’attribution du nom de famille que se marque la dépendance entre filiation et identité sociale. En sociologie, le lien social désigne l’ensemble des relations qui unissent des individus faisant partie d’un même groupe social et qui établissent des règles. Avec Claude Lévi-Strauss, l’anthropologie décèle dans la prohibition de l’inceste le modus operandi fondant la transition entre deux ordres, les faits de nature et les faits de culture. S’interdire l’accès aux femmes de son groupe, c’est s’obliger à épouser d’autres femmes étrangères au groupe ; cet échange seul permet d’établir une relation durable entre des groupements humains autrement voués à l’isolement et au conflit. Au regard de la psychanalyse, le sujet est le produit d’une histoire qui est celle de son insertion dans l’ordre de la loi et du langage, champ symbolique qui dépasse les individus, où père et mère occupent des lieux assignés. La psychanalyse distingue des fonctionnements qui relèvent des structures où chacun se trouve pris, elle s’intéresse à la « préhistoire », à l’histoire originaire, fondatrice. C’est cette préhistoire sociale originaire, cette histoire du commencement que Freud a développée dans Totem et tabou qui traite du passage de la horde primitive – pure animalité – à l’univers social.
Il nous faut repenser nos catégories de pensée, nos héritages symboliques. Nous devons réinventer notre quotidien, faire preuve d’inventivité, de créativité. Il faut lutter contre l’ignorance, l’analphabétisme, l’obscurantisme, ne pas confondre science et croyances. Tout cela impose de donner davantage de place à la culture. Certes la santé des citoyens, leurs besoins économiques, leur sécurité sont essentiels, mais la culture n’est pas une chose superflue. Elle contribue à élever le degré de conscience, à éduquer, à développer les connaissances. Elle est elle-même source de productivité. J’évoquerai quelques situations pour appuyer ces réflexions.
Il y a d’abord toute l’importance à accorder à la question du patrimoine. Un effort important a été entrepris pour la restauration des monuments historiques. La société civile est de plus en plus consciente de la place à accorder à ces pages de notre histoire. Un exemple nous l’a montré. Dans le cadre de cette restauration, le célèbre café maure de Rabat a été malheureusement détruit pour être reconstruit « à l’identique » a-t-on affirmé. Cette destruction est fort regrettable. Lorsque les traces du passé sont effacées, aucune reconstruction ne peut se faire à l’identique. Fort heureusement, les citoyens ont très fortement réagi pour condamner cette destruction. Suite à cela, il a été convenu que les décisions seront désormais prises en concertation avec les acteurs de la société civile. Saluons au passage l’appel redoublé pour le développement du tourisme intérieur en cette période de forte restriction des déplacements à l’extérieur du pays. Cette initiative pourra, sans nul doute, ouvrir la voie à meilleure connaissance du pays.
Durant le confinement les librairies ont été fermées. De nombreuses voix se sont soulevées contre cette décision. Cette mesure, tout à fait justifiée lorsque les locaux ne permettent pas une distanciation, pourrait donner lieu à d’autres perspectives. Ainsi, la possibilité de mettre en place des bibliothèques ambulantes, en plein air, donnerait un nouveau souffle au livre et à la lecture. Je cite ici en exemple l’action menée par la libraire Jamila Hassoun. Afin de rendre le livre accessible au plus grand nombre, elle a lancé il y a plusieurs années déjà « la caravane du livre », un espace culturel mobile qui se déplace aux quatre coins du Royaume pour offrir des moments de découverte et de partage autour du livre à travers des débats et des tables rondes, dans les régions les plus reculées du pays.
En pleine crise de la Covid 19 et pour la première fois depuis que le cinéma existe, les salles de cinéma ont été contraintes de fermer leurs portes. Face à cela, une vieille initiative, remontant aux années soixante, mérite d’être remise à l’ordre du jour : « Le Drive-In Festival », un cinéma en plein air sur un grand parking de voitures. Les cinéphiles peuvent s’installer et profiter des films et des différentes animations sur un écran géant. La création d’un festival itinérant et solidaire, peut aider les distributeurs en difficulté et garder le lien avec le public.
L’un des effets de la crise les plus marquants a été le développement considérable du digital. Ainsi, la transmission instantanée des informations et des échanges par smartphones, Skype, zoom, e-mails, audios, vidéos… nous permettent d’être proches tout en étant éloignés. Nous sommes loin du passé lointain durant lequel les hommes et les pays étaient coupés les uns des autres. La situation sanitaire actuelle nous contraint à remplacer les salles de conférences par des visioconférences, d’organiser des congrès et même des salons virtuels grâce aux plateformes numériques. Nous ne devons cependant pas oublier que dans de nombreuses situations le numérique reste une solution palliative qui ne remplace pas les échanges en présence physique, la digitalisation des relations sociales étant insuffisante et pouvant devenir pathogène. On a enfin assisté à une extraordinaire multiplication des fake news, d’où la nécessité de vérifier les informations afin de réussir à acquérir une capacité de réflexion et de discernement du vrai et du faux. On peut ainsi garder le meilleur de la révolution numérique.
Aujourd’hui nous savons qu’il va falloir vivre avec la Covid-19 pour un temps encore indéterminé. Il faudra donc gérer les risques sur les secteurs politique, économique, sanitaire notamment. La santé est le domaine où chacun doit apprendre à se protéger et protéger les autres. Il faut donc que le citoyen soit acteur de sa propre protection, ce qui suppose une action quotidienne. L’éducation, la pédagogie, la culture sont des éléments essentiels pour développer la responsabilité et la prise de conscience des citoyens. Au début de cette pandémie le mot « guerre » a été utilisé, par certains hommes politiques, à l’échelle mondiale. L’objectif était d’alerter la population sur l’urgence de la situation afin de sauver des vies. On a parlé de « l’ennemi invisible », qui cherche à tuer sa proie. J’ai écouté les peurs ayant accompagné cette période. Ainsi, la métaphore de « la guerre » nous rappelle que face à la peur de la mort, les individus ont des réflexes de survie, grâce aux pulsions de vie qui s’opposent aux pulsions de mort.
« Pourquoi la guerre ? » Vieille question, toujours actuelle, qui fut posée dans un dialogue entre deux grands au cours du siècle dernier. En 1931, la Société des Nations cherchait à promouvoir un échange entre les intellectuels en faveur de la paix. Einstein faisait remarquer que les États créent une autorité judiciaire pour apaiser les conflits et soumettre les hommes aux lois. Freud rappelait que dans le psychisme coexistent deux grands groupes d’instincts, les instincts de destruction, d’agressivité et les instincts d’amour, de conservation. Il en résulte un jeu entre l’intérieur et l’extérieur, un équilibre dirigé vers l’intérieur ou l’extérieur. Dans la « vie civilisée », les instincts de conservation triomphent sur les instincts de destruction qui engendrent l’agressivité et la violence. Le travail de l’éducation et de la culture doit faire son œuvre pour contenir ces pulsions dans le sens de la préservation de la vie, du souci de soi et des autres.
Jalil Bennani
Jalil Bennani
Septembre 2020